Le QUIZZ 29
![[Image]](pict1.jpg)
QUESTION
Qui est APOPHIS et comment s'en débarrasser ?
| Sujet | intervenant | date |
| Astéroïdes, météorites, comètes : origine et différence ? | Jean-Pierre MARTIN | 7 Mars 2009 |
La réponse est en rouge
 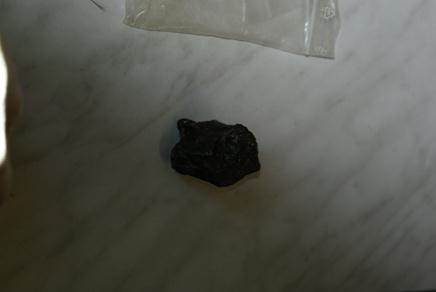 |  |
Faut-il
craindre que le ciel nous tombe sur la tête ? C'est un peu ce que nous a
demandé Jean-Pierre durant ces deux heures extraordinaires ! Non seulement il
maîtrise le sujet parfaitement,
mais en prime, il sait de façon enjouée et
vivante, expliquer à son auditoire les risques (mesurés) qui nous menacent.
Il commence tout d'abord par nous rappeler que cette année
2009 est exceptionnelle, puisqu'elle fête les 400 ans de l'astronomie.
C'est en effet en 1604 que Galilée eut le premier, l'idée
de diriger vers le ciel une "lunette grossissante" (inventée
par des hollandais). C'est lui qui le premier donc,
observa les cratères de la
Lune, Jupiter et ses satellites. Cette observation allait à cette époque
conforter les théories de Copernic et mettre à bas les croyances de l'époque :
la Terre n'est pas le centre de l'Univers, mais tourne bel et bien autour du
Soleil. On se doute que ces affirmations n'étaient pas du goût de tout le
monde...
Jean-Pierre plante ensuite le décor de notre Univers :
le Soleil est une étoile semblable aux milliers d'autres que nous voyons dans
le ciel. Comme les humains, elles vivent en groupes...
C'est ce que l'on nomme
une Galaxie. Il y aurait, au-dessus de nos têtes plus de 100 milliards
d'étoiles réparties dans 100 milliards de Galaxies. Beau voyage à faire pour
tout visiter.
D'autant que l'éloignement est tel qu'on ne peut plus calculer en
kilomètres, mais en AL = années lumière. Il faudrait dès lors 100 mille années
lumière pour traverser notre Galaxie.
Ensuite, notre Terre se trouvant à 150 Millions de
kilomètres du Soleil, il est clair que les distances des planètes plus
éloignées deviennent difficiles à estimer.
On a donc préféré calculer en UA =
Unités astronomiques. 1 cm = 150 Millions de km. Ainsi si la Terre se trouve à
1 UA, Jupiter se trouve à 5 UA du Soleil et ce vieux Pluton
(qui n'est plus une
planète) à 40 UA.
Et là, cela fait réfléchir : la première étoile (donc un
autre Soleil) se trouve à 300 000 UA. C'est Proxima du Centaure. Avec dans cet
immense espace intermédiaire :
du vide... Jean-Pierre compare à échelle
humaine: si le Soleil était une orange posée sur la table de notre salon (ou
cuisine, peu importe...) l'orange Proxima se trouverait à 1300 kilomètres de là
!
La création de notre Univers : 4, 5 milliards
d'années. Suite sans doute à l'explosion d'une Super Nova, un gigantesque nuage
de gaz en rotation s'effondre, se condense en grains
(un peu comme des grumeaux
dans une pâte à crêpes), devient la matière solaire. Chaleur, attraction. C'est
la naissance non seulement des planètes, mais aussi des comètes et autres
astéroïdes.
Les astéroïdes
Ce sont des "petits morceaux de roches" que
l'on trouve essentiellement entre Mars et Jupiter. Pourquoi là ? Jean-Pierre
surprend tout le monde
(enfin ceux qui n'y connaissent pas grand chose. j'en
suis...) tout simplement parce que lors de la création de notre Univers, donc
il y a 4,5 milliards d'années, les planètes
se sont distribuées dans l'espace
de façon régulière (selon les Lois de Keppler ; là c'est Jean-Pierre qui
parle...) et qu'entre Mars et Jupiter : IL MANQUE UNE PLANETE...
Logique,
puisque celle-ci n'a pu se constituer à l'époque : l'attraction du Soleil et
celle de Jupiter (grosse boule gazeuse 11 fois plus grosse que la Terre) se
faisant front,
la matière n'a pu trouver sa place pour tourner gentiment et
s'est transformée en gros morceaux épars : les astéroïdes (16 000 ont été
répertoriés, formant
ce que l'on nomme une ceinture
d'astéroïdes).
Les comètes
Ce sont des gros morceaux, plus constitués de glace
que de roches, et qui seraient à l'origine de l'eau sur notre planète. A force
de bombarder la Terre, ces objets volants
auraient déposé plus de 50 % de notre
eau. Les 50 % restants demeurant constitués par la vapeur s'échappant des
volcans. Ici deux constatations : les comètes sont aussi vieilles
que notre Terre, et sans elles, il n'y aurait pas eu de vie possible. En
fait, ces gros rochers glacés proviennent du fin fond de l'Univers et,
eux-aussi capturés par l'attraction du Soleil,
tournent de façon elliptique
autour de lui. Lorsqu'elles sont loin, la glace qui les constitue se solidifie
; lorsqu'elles s'approchent du Soleil, cette glace fond, entraînant dans le
ciel
ce que l'on nomme une queue de Comète. Et hop, elle repart se congeler au
fin fond de l'Univers, ayant perdu un peu de son poids et de ses composants.
Rien de grave cependant
(un peu de perte de poids ne fait de mal à personne).
Leur masse est telle que l'approche du Soleil ne fait que les faire ... suer un
peu !
Voilà pourquoi, régulièrement apparaissent des Comètes,
dont la plus célèbre, est certainement la Comète de Halley, visible dans notre
ciel tous les 74 ans. Les écrits l'évoquent déjà en 476,
puis 87 avant J. C. Ce
sont ensuite grandes quantités de faits historiques liés à son passage : On la
retrouve sur la tapisserie de Bayeux évoquant la bataille de Hastings.
Guillaume le Conquérant, ayant prit le passage de la comète de Halley comme un
signe favorable, envahit l'Angleterre en 1066. On la retrouve en 1682,
puis 1758 (Les anciens s'en souviennent..) etc.
Les comètes les plus connues
sont :
Encke
Hyakutake
Hall Bopp
Mac Naught
Holmes
Mais aussi Shoemaker Levi 9 qui fut capturée par les forces
de marée de Jupiter (tiens tiens, encore lui !) en 1993. Jean-Pierre nous
présenta d'ailleurs une photo remarquable montrant,
dans l'épaisseur de cette grosse planète, les
impacts provoqués par l'éclatement de cette comète. Certaines,
en effet, finissent leur course de façon brutale : soit aspirées par le Soleil,
soit fragmentées, cassées en morceaux.
Jean-Pierre évoque alors Giotto, une sonde envoyée par les
européens qui passa à 600 kilomètres de la comète de Halley. La chaleur émise
brûla les caméras de ce petit robot,
le rendant aveugle jusqu'à la fin des
temps (ou du moins de son temps)
Autres points forts
dans l'étude des comètes :
Stardust : Projet américain initié pour récupérer dans l'espace, à
l'aide d'une "raquette de tennis" imbibée d'aérogel, les
particules circulant autour d'une comète
(histoire d'étudier sa composition).
C'est le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris qui est, entre autre, chargé de
cette étude.
Deep Impact : Le 4 Juillet 2005 (jour de l'Indépendance américaine..) un
impacteur (grosse boule de bowling) percuta la comète Tempel 1, pendant qu'un
capteur placé non loin
récupérait les particules ainsi obtenues.
Il faut dire que se poser
sur une comète est extrêmement difficile.
Ainsi Rosetta (qui
tire son nom de la "pierre de rosette", chère à Champollion) est en
route pour se poser sur la comète Churiomov Gerasimenko, qu'elle atteindra en
2013 ou 2014.
Philaé, un petit module ancreur tentera alors d'atterrir... heu
de "cométir". Jean-Pierre nous présente les panneaux solaires
gigantesques déployés par Rosetta (les plus grands
ayant jamais existé) ;
l'éloignement phénoménal du Soleil ne permettant pas, sans cela, à cette expédition
de bénéficier d'assez d'énergie pour se propulser. Vraiment, les hommes,
quand
ils le veulent, sont capables de grandes choses ! (Ce projet est européen :
ASE).
Les météorites
Ce sont des "corps matériels extraterrestres" qui se promènent dans l'Univers
qui parfois voient brûler la matière qui les compose. Ce sont dès lors ce que
l'on nomme
des étoiles filantes. Certaines s'écrasent sur le Terre, traversant
l'atmosphère et provoquant des impacts terribles. Heureusement, ces chocs sont
très rares et il est inutile
de demander à Bruce Willis d'aller se faire
exploser sur l'une d'elle, comme dans le film Armageddon !
Jean-pierre a présenté à l'assistance ébahie (voir les photos) une
météorite, dont la naissance date de la création de l'Univers elle aussi.
Quelle pièce de collection
(très recherchées car très rares ; ici,
Danielle, amie et assistante de Jean-Pierre posa une devinette : "Où
trouve-t-on facilement les météorites tombées sur la Terre ?"
Réponse :
- Dans nos gouttières, en passant un petit aimant ; tout ce
qui "s'y colle" provient du ciel.
- Aux pôles et dans la neige (facile de retrouver leur
trace de couleur sombre)
- Dans les déserts (pour la même raison.)
Il existe plusieurs sortes
de météorites :
- Les chondrites (petits
fragments d'astéroïdes)
- Les métalliques
- Les ferriques
- les mixtes
- D'autres proviendraient de
Mars.
La Kaaba, pierre sacrée des Musulmans, serait une
météorite.
Il tombe plusieurs tonnes de météorites par jour sur la Terre;
cependant celles-ci arrivent à l'état de poussière ; rarement en
gros blocs ; du moins depuis des milliers d'années.
Il n'empêche que des traces
de collision sont encore visibles sur Terre :
Meteor cratère : tombé voici 25 000 ans dans le désert de
l'Arizona. Il fut acheté en 1903 par Daniel Moreau Barringer, qui croyait faire
fortune en vendant les métaux récupérés
dans ce cratère de 1200 m de diamètre; mal lui
en prit car la force de l'impact (72 000 km/h !) fit fondre dans la nature tous
ces dits-composants.
Manicouagan au Canada. Le plus beau des
cratères.
Souvenons-nous (enfin, façon de parler..) de cette
gigantesque collision qui, voici 65 Millions d'années, dans le Yucatan, au
Mexique, provoqua la disparition non seulement des dinosaures,
mais également
de 90 % de la faune d'alors. Un nuage gigantesque cacha durant des années le
Soleil, empêchant la photosynthèse de se faire, et donc aux arbres d'avoir des
feuilles.
Les herbivores moururent faute de nourriture, suivis par les animaux
qui mangeaient les herbivores et ainsi de suite dans la chaîne alimentaire. Il
est assez difficile pour nous les hommes, d'imaginer que nos ancêtres (des
petits mammifères semblables à des rats) survécurent car ils vivaient dans des
grottes et des espaces confinés.
Notre Terre n'a pas, comme les autres planètes un aspect
aussi "impacté", pétri de cratères. Ce n'est donc pas parce qu'elle
est épargnée par les chutes des corps célestes.
Cela est dû essentiellement à :
- La dérive des continents :
Les gigantesques mouvements de la croûte terrestre au cours de ces millions
d'années ont gommé l'effet des impacts.
- La couche d'atmosphère qui
nous entoure. Celle-ci a certainement freiné, voire fait exploser les attaquants.
- la Lune, qui a
certainement également écarté les intrus de notre route.
Juste une question : que
faites-vous le vendredi 13 Avril 2029 ? Rien ?
Cela vous dirait-il d'accueillir APOPHIS, un gros intrus qui
va passer près de la Terre (1 chance sur 200 pour que l'impact ait lieu
soit l'équivalent de 60 000 bombes d'Hiroshima).
Et s'il passe sa route, il
reviendra le 13 Avril 2036. Choc ? Pas choc ?
Les scientifiques s'interrogent et tirent des plans... sur la
Comète..; Comment réagir ? Provoquera-t-il un Tsunami là où il s'écrasera
(soyons optimistes : là où il s'écraserait) ?
Fera-t-il d'immenses dégâts
(notamment aux Etats Unis où les chercheurs le prévoient). Détruira-t-il la
Terre entière ? (Cela est peu probable). Et que faire pour se protéger ?
(excepté prier bien sûr !) :
- Quitter la Terre (...) ?
- Faire exploser Apophis, ce
qui mettrait, à l'approche de la Terre, des milliers d'impacteurs dangereux (Oh
oh, mauvaise idée !)
- Le peindre ? Non pas pour le
rendre plus joli, mais pour changer sa réflexibilité (c'est à dire sa propriété
à capter les rayons du Soleil ; ce qui le détournerait de sa route meurtrière).
- Cacher le Soleil derrière un
miroir géant ?
- Provoquer une explosion près
de lui pour que le souffle détourne sa route ?
- Le tracter au loin ?
- Y installer un moteur ? Etc.
Les scientifiques restent vigilants, même si, une fois
encore, il semblerait que les chercheurs notamment américains ne prennent pas
l'exacte mesure des risques...
N'hésitez pas à vous rende sur le site de Jean-Pierre :
http://www.planetastronomy.com
http://www.planetastronomy.com/